12 décembre 2008
5
12
/12
/décembre
/2008
10:23
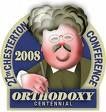 Il y a cent ans paraissait en Angleterre un petit livre, appelé à faire du bruit : Orthodoxy. Son auteur, G.K. Chesterton, jeune journaliste et écrivain, s’était déjà illustré en publiant trois ans auparavant un livre détonnant, au titre provocateur, Heretics. Orthodoxy prenait donc la suite de ce précédent livre, et continuait, en l’élargissant, le même sillon. À vrai dire, le titre même d’Orthodoxy n’avait rien de surprenant de la part d’un auteur qui avait déjà donné ce titre au premier et au dernier chapitre d’Heretics. Dans ce livre qui s’en prenait joyeusement aux maîtres du moment, en dénonçant sophismes et croyances superstitieuses dans les forces du progrès, Chesterton avait clairement annoncé la couleur en titrant son premier chapitre : « Remarque préliminaire sur l’importance de l’orthodoxie » pendant qu’il donnait pour titre au dernier chapitre conclusif, « Observations finales sur l’importance de l’orthodoxie ».
Il y a cent ans paraissait en Angleterre un petit livre, appelé à faire du bruit : Orthodoxy. Son auteur, G.K. Chesterton, jeune journaliste et écrivain, s’était déjà illustré en publiant trois ans auparavant un livre détonnant, au titre provocateur, Heretics. Orthodoxy prenait donc la suite de ce précédent livre, et continuait, en l’élargissant, le même sillon. À vrai dire, le titre même d’Orthodoxy n’avait rien de surprenant de la part d’un auteur qui avait déjà donné ce titre au premier et au dernier chapitre d’Heretics. Dans ce livre qui s’en prenait joyeusement aux maîtres du moment, en dénonçant sophismes et croyances superstitieuses dans les forces du progrès, Chesterton avait clairement annoncé la couleur en titrant son premier chapitre : « Remarque préliminaire sur l’importance de l’orthodoxie » pendant qu’il donnait pour titre au dernier chapitre conclusif, « Observations finales sur l’importance de l’orthodoxie ».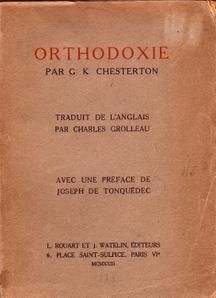 Comment allait-il commencer ce nouveau livre qui portait haut le titre d’Orthodoxy ? En intitulant le premier chapitre « Remarque préliminaire sur les dangers de l’hérésie » et en concluant par des « Observations finales sur les dangers de l’hérésie » ? La facétie chestertonienne n’alla pas jusque-là. C’était trop attendu ; trop évident. Il prit donc des chemins de traverse, des sentiers escarpés, des voies inexplorées, des parcours pour le moins inattendus.
Comment allait-il commencer ce nouveau livre qui portait haut le titre d’Orthodoxy ? En intitulant le premier chapitre « Remarque préliminaire sur les dangers de l’hérésie » et en concluant par des « Observations finales sur les dangers de l’hérésie » ? La facétie chestertonienne n’alla pas jusque-là. C’était trop attendu ; trop évident. Il prit donc des chemins de traverse, des sentiers escarpés, des voies inexplorées, des parcours pour le moins inattendus.Après une courte préface, Chesterton propose neuf chapitres qui, à la fois, révèlent l’aspect surprenant du livre et donne une idée du sujet abordé. Il existe pour le livre dans son intégralité deux traductions françaises. La première est de Charles Grolleau et elle date des années 20. Elle est accompagnée d’une préface du Père Joseph de Tonquédec, célèbre jésuite, passionné par Chesterton, auquel il consacrera un ouvrage. De couverture marron, cette édition paraît chez « L. Rouart et J. Watelin, éditeurs, 6 place Saint-Sulpice, Paris VIe ». Charles Grolleau propose comme traduction des titres de chapitre :
I– Introduction
II– Le fou
III– Le suicide de la pensée
IV– L’éthique du pays des fées
V– Le drapeau du monde
VI– Les paradoxes du christianisme
VII– L’éternelle révolution
VIII– Le romantisme de l’orthodoxie
IX– Autorité et aventure
Une autre traduction française paraît en 1984 aux éditions Gallimard, dans la collection Idées. Elle est l’œuvre d’Anne Joba, qui traduit un peu différemment certains chapitres. Ce qui donne pour la table des matières :
I– Introduction
II– Le dément
III– Le suicide de la pensée
IV– Ethiques au royaume des elfes
V– Le drapeau du monde
VI– Les paradoxes du christianisme
VII– La révolution éternelle
VIII– Le roman de l’orthodoxie
IX– L’autorité et l’aventurier
Le plus simple, certainement, est de donner le sommaire en langue anglaise :
I. Introduction in Defence of Everything Else
II. The Maniac
III. The Suicide of Thought
IV. The Ethics of Elfland
V. The Flag of the World
VI. The Paradoxes of Christianity
VII. The Eternal Revolution
VIII. The Romance of Orthodoxy
IX. Authority and the Adventurer
Comme il arrive souvent les traductions françaises ne reprennent pas la préface de l’auteur (c'est le cas aussi de certaines éditions anglaises). Celle d’Orthodoxy, dont nous livrerons bientôt aux abonnés à la Lettre d'information [Un conseil : abonnez-vous, c'est gratuit. Voir ci-contre] une traduction, est intéressante. De manière anecdotique d’abord, en ce qu’elle associe Hérétiques et le nouveau livre qui vient de paraître, en parlant de « compagnon ». De manière plus profonde, puisque Chesterton n’hésite pas à présenter ce livre comme un ouvrage très personnel, qui n’explique pas les raisons universelles de croire au christianisme, mais ses propres raisons à lui d’y croire. De ce fait, les premières lignes du premier chapitre (Introduction) sont beaucoup plus compréhensibles quand il écrit :
« La seule excuse que je puisse donner pour avoir écrit ce livre c’est qu’il répond à un défi. Un escrimeur médiocre s’honore en acceptant un duel. Quand, il y a quelque temps, j’ai publié une série d’articles hâtivement écrits mais sincères, sous le titres de « Hérétiques », plusieurs écrivains dont l’intelligence m’inspire un profond respect (je citerai en particulier M. G.S. Street) dirent que j’avais amplement raison d’inviter tout le monde à donner sa théorie de l’univers mais que j’avais soigneusement évité d’appuyer mes préceptes par l’exemple. “Je commencerai à me fatiguer de ma philosophie, a dit M. Street, quand M. Chesterton m’aura donné la sienne”. C’était là peut-être faire une imprudente suggestion à quelqu’un qui n’est que trop prêt à répondre par des livres à la provocation la plus légère. Mais, après tout, bien que M. Street soit l’inspirateur, le créateur de ce livre, il n’est pas nécessaire qu’il le lise. S’il le lit, il trouvera que j’ai essayé dans ces pages, d’une façon imprécise et toute personnelle, par un choix de peintures mentales plutôt que par une série de déductions, d’exposer la philosophie à laquelle je suis arrivé à croire. Je ne l’appellerai pas ma philosophie, car je ne l’ai pas faite. Dieu et l’humanité l’ont faite et elle m’a fait moi-même » (traduction Grolleau).
 Le ton est donc donné. Mais ce qui est intéressant, c’est que dans sa courte préface, Chesterton se place sous l’autorité du grand cardinal Newman, non pas directement en matière d’argumentation, mais pour expliquer que, à l’instar de l’Apologia pro vita de Newman, il utilise abondamment dans Orthodoxie la première personne du singulier. La comparaison entre les deux ouvrages va d’ailleurs beaucoup plus loin. L’Apologia de Newman est une réponse à une provocation et à une attaque de Charles Kingsley. Orthodoxie est une réponse à une demande d’explication qui est, de manière policée, une attaque contre Chesterton. Orthodoxie apparaît donc bien comme l’Apologia de Chesterton. Dans un autre style, avec une autre histoire, une autre manière de présenter les choses. S’il fallait définir Orthodoxie, c’est bien d’une Histoire d’une âme qu’il faudrait parler, comme l’Apologia de Newman est son histoire d’une âme, forcément différente, très différente même, de celle de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Mais histoire d’une âme quand même.
Le ton est donc donné. Mais ce qui est intéressant, c’est que dans sa courte préface, Chesterton se place sous l’autorité du grand cardinal Newman, non pas directement en matière d’argumentation, mais pour expliquer que, à l’instar de l’Apologia pro vita de Newman, il utilise abondamment dans Orthodoxie la première personne du singulier. La comparaison entre les deux ouvrages va d’ailleurs beaucoup plus loin. L’Apologia de Newman est une réponse à une provocation et à une attaque de Charles Kingsley. Orthodoxie est une réponse à une demande d’explication qui est, de manière policée, une attaque contre Chesterton. Orthodoxie apparaît donc bien comme l’Apologia de Chesterton. Dans un autre style, avec une autre histoire, une autre manière de présenter les choses. S’il fallait définir Orthodoxie, c’est bien d’une Histoire d’une âme qu’il faudrait parler, comme l’Apologia de Newman est son histoire d’une âme, forcément différente, très différente même, de celle de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Mais histoire d’une âme quand même.


/idata%2F1920403%2FGKC-4%2FEugenics-GKC.png)
/idata%2F1920403%2FGKC-4%2FL-Homme-qui-en-savait-trop.png)
/idata%2F1920403%2FGKC-4%2FCouverture-L-homme-trop.png)
/idata%2F1920403%2FGKC-4%2FWhat-I-Saw.png)